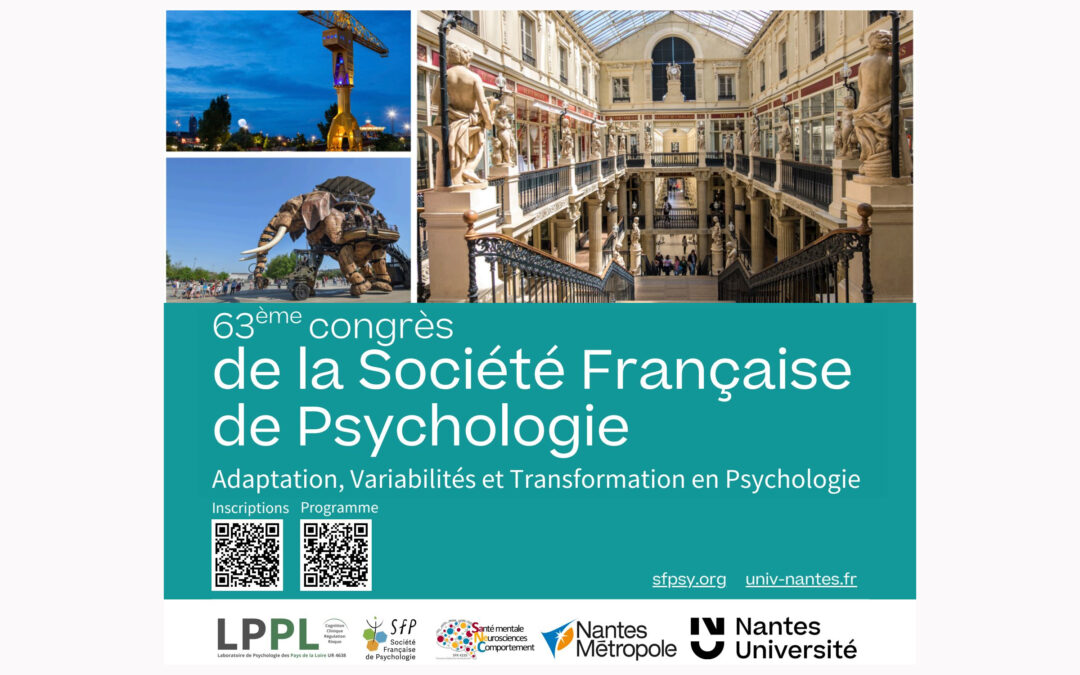Alexandre Heeren

Stress and Anxiety Research Lab
Université catholique de Louvain
Biographie
Alexandre Heeren est professeur de psychologie clinique et chercheur qualifié du FNRS à l’UCLouvain, où il dirige depuis 2019 le Stress and Anxiety Research Lab. Ses travaux portent principalement sur les mécanismes émotionnels et cognitifs sous-tendant l’anxiété et le stress — dans leurs dimensions tant adaptatives que pathologiques — ainsi que sur la modélisation de leurs interactions. Plus récemment, il a élargi ses recherches aux enjeux de santé mentale liés à la transition écologique, en particulier à travers le prisme de l’éco-anxiété. Auteur de nombreuses publications internationales, il a reçu plusieurs distinctions, dont le prestigieux STAR Early Career Award (2021), saluant sa contribution exceptionnelle à la recherche sur le stress, l’anxiété et la résilience.
Santé mentale, éco-anxiété et crise climatique: De la paralysie à l’action
De plus en plus de personnes font l’expérience d’émotions négatives intenses et de détresse à l’égard du changement climatique, et plus largement de la crise écologique. Ce phénomène est souvent qualifié d’éco-anxiété. Cela étant, la nature même de ce phénomène ainsi que son rôle potentiellement adaptatif (ou paralysant) face à la transition écologique suscitent encore de nombreuses questions. Durant cette présentation, après une brève introduction sur les enjeux posés par la crise écologiques en termes de santé mentale, Alexandre Heeren passera en revue les connaissances scientifiques actuelles autour de ces questions. Les défis thérapeutiques, sociétaux mais aussi environnementaux posées par l’éco-anxiété seront également discutés.
Cyril Thomas

Laboratoire de Psychologie UR 3188-Institut Universitaire de France (IUF)
Université Marie & Louis Pasteur
Biographie
Cyril Thomas est maître de conférences en psychologie cognitive à l’Université Louis et Marie Pasteur et membre de l’Institut Universitaire de France. Il consacre ses recherches à l’étude des biais perceptifs et de raisonnement, en s’appuyant sur un outil expérimental original : la prestidigitation. Ses travaux sur la perception s’intéressent particulièrement aux processus cognitifs en jeu dans les phénomènes d’anticipation perceptive ainsi qu’à l’influence d’heuristiques sur l’interprétation de séquences visuelles simples. Ses recherches sur le raisonnement s’articulent essentiellement autour du phénomène de fixation de la pensée dans le domaine de la résolution de problèmes. Parallèlement à sa carrière académique, il est illusionniste depuis plus de vingt ans. En 2025, il publie avec le professeur André Didierjean un ouvrage de référence aux éditions Odile Jacob, dans lequel il dévoile les secrets psychologiques des magiciens à travers de nombreuses expériences scientifiques menées dans ce domaine de recherches.
La Psychologie de la prestidigitation
Les magiciens trompent souvent l’esprit des spectateurs en s’appuyant sur certaines de leurs limites cognitives. Le nombre de recherches mettant en lien la magie et la psychologie a considérablement augmenté ces dix dernières années, cette thématique offrant un terrain original pour étudier l’attention, la perception ou encore le raisonnement. Dans cette conférence Cyril Thomas présentera plusieurs recherches qui s’inscrivent dans cette perspective. Il discutera de l’intérêt de cette « étude expérimentale de la magie » à travers plusieurs illustrations expérimentales. Vous apprendrez notamment comment les magiciens détournent notre attention, manipulent notre raisonnement et nos choix, nous font voir ce qui n’existe pas et nous rendent aveugle à ce qui se trouve sous nos yeux.
Lyda Lannegrand

Laboratoire de Psychologie EA4139
Université de Bordeaux
Biographie
Lyda Lannegrand est professeure de psychologie du développement et de l’éducation à l’université de Bordeaux, au sein de laquelle elle assure les fonctions de Directrice adjointe du Laboratoire de Psychologie UR 4139 et de Directrice du Centre de Formation des Psychologues de l’Education Nationale (CFPsyEN). Ses thèmes de recherche portent sur le développement psychosocial et socio-émotionnel de l’adolescent et du jeune adulte et s’organisent en 3 axes : la construction identitaire de l’adolescence à l’entrée dans l’âge adulte ; les relations avec les parents et la famille et leur rôle dans le développement psychosocial et socio-émotionnel de l’adolescent ; le rapport au monde social (rapport aux normes, à la citoyenneté, engagement civique et politique) des adolescents et des jeunes adultes.
La construction de l’identité des adolescents et des jeunes adultes dans le monde d’aujourd’hui : diversité des profils identitaires et adaptation psychosociale
La construction de l’identité, c’est-à-dire l’élaboration d’un sens cohérent de soi et de son identité, constitue une tâche développementale essentielle de l’adolescence à l’entrée de l’âge adulte. Elle permet à l’individu de se situer et se positionner personnellement par rapport à des enjeux cruciaux (comme les perspectives d’orientation scolaire et professionnelle, les relations interpersonnelles, le rapport à l’autre sexe, les valeurs, les croyances, les plans de vie, etc.). L’adolescence est ainsi une période d’ouverture personnelle au monde reposant sur des processus d’exploration.
Dans le cadre de cette conférence, il s’agira de souligner les spécificités de la construction identitaire des adolescents et des jeunes adultes, puis d’exposer la diversité des profils identitaires, tels qu’ils sont actuellement mis en évidence dans la littérature scientifique, et leurs liens avec l’adaptation psychosociale.
Marie Préau

Unité Inserm 1290
Université Lumière Lyon 2
Biographie
Marie Préau est professeure de psychologie sociale de la santé à l’Université Lumière Lyon 2 et directrice de l’Unité Inserm 1296. Chargée de mission sur la stratégie scientifique en santé au sein de l’Université Lyon 2, elle a toujours été investie autour des enjeux psychosociaux de la prévention et de la prise en charge des maladies chroniques dont le cancer. Très impliquée dès ses premiers travaux dans les approches participatives et les questions de recherche relatives à la qualité de vie, Marie Préau est investigatrice de nombreux projets de recherches communautaires dans différents domaines qui ont donné lieu à plus de 150 publications scientifiques.
Marie Préau siège dans différentes instances d’expertise et d’évaluation, commission scientifique spécialisé de l’ANRS, commission santé publique, SHS et épidémiologie (CSS6) de l’Inserm. Elle est membre du Conseil National du Sida, du comité d’Évaluation Éthique de l’Inserm et du Conseil Scientifique de la Ligue contre le Cancer.
La qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques : déterminants psychosociaux et modalités de recherche
Cette communication vise à présenter les enjeux psychosociaux auxquels sont confrontés les personnes atteintes de maladies chroniques et leurs impacts sur la qualité de vie. Il s’agira de revenir sur les enjeux théoriques et méthodologiques du concept de qualité de vie mais aussi d’aborder les démarches de recherche innovantes qui permettent d’appréhender ces questions de recherche et de nourrir les enjeux théoriques de la psychologie sociale de la santé mais aussi d’apporter des données empiriques susceptibles de faire évoluer les pratiques de terrain.
Sébastien Goudeau

Professeur de psychologie sociale
Laboratoire CeRCA (UMR CNRS 7295)
Université de Poitiers
Biographie
Sébastien Goudeau, ancien professeur des écoles, est aujourd’hui Professeur des universités en psychologie sociale à l’Université de Poitiers. Il conduit ses recherches au Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA, UMR CNRS 7295) et est responsable de l’INSPE de Niort.
La construction des inégalités scolaires à l’école maternelle
Pourquoi les inégalités scolaires liées à l’origine sociale émergent-elles si tôt dans le parcours éducatif ? Si de nombreuses recherches en psychologie pointent les caractéristiques individuelles des élèves ou les pratiques parentales comme causes principales, elles négligent souvent un aspect essentiel : le rôle des situations scolaires elles-mêmes.
Lors de cette conférence, je présenterai des travaux récents qui interrogent les mécanismes de construction des inégalités à l’école maternelle. Nos recherches montrent que les contextes de regroupement en classe favorisent la prise de parole des élèves de milieux favorisés, dont la socialisation s’aligne davantage sur les attentes scolaires. En revanche, les enfants de milieux populaires participent moins, prennent moins souvent la parole spontanément et s’expriment sur des durées plus courtes, indépendamment de leur niveau langagier.
D’autres études révèlent que ces différences sont souvent interprétées par les élèves comme le reflet de qualités personnelles (e.g., intelligence, effort, personnalité) plutôt que de facteurs externes, renforçant ainsi le sentiment de compétence et d’appartenance des élèves favorisés et, potentiellement, leur engagement scolaire.
Enfin, je présenterai une intervention destinée aux enseignants visant à rééquilibrer la répartition de la parole en classe et à réduire les inégalités dans le développement des compétences langagières.